L'affaire de Montigny,
incroyable gâchis causé par "la religion des aveux"
Les aveux
sont considérés par beaucoup comme la "reine des preuves".
Plusieurs affaires, décrites notamment par l'avocat
Dominique Inchauspé dans "L'erreur judiciaire" (aux Presses
universitaires de France) montrent que cette confiance
excessive mène à des erreurs. La plus exemplaire, par
l'accumulation d'aveux (de trois personnes différentes), par
les nombreuses incohérences du dossier d'accusation et par
l'ampleur de ses suites catastrophiques, est celle commise
par la justice dans "L'affaire de Montigny" dite
"Dils-Heaulme".
28 septembre 1986, à
Montigny-lès-Metz (département de la Moselle, Est de la
France), en début de soirée, deux enfants sont découverts le
crâne fracassé.
L'équipe de l'inspecteur divisionnaire Varlet, directeur de
l'enquête, obtiendra dans les mois qui suivent les aveux de deux
personnes. Mais il dut chaque fois reconnaître peu après que les
récits des meurtres obtenus de ces deux suspects étaient trop
invraisemblables.
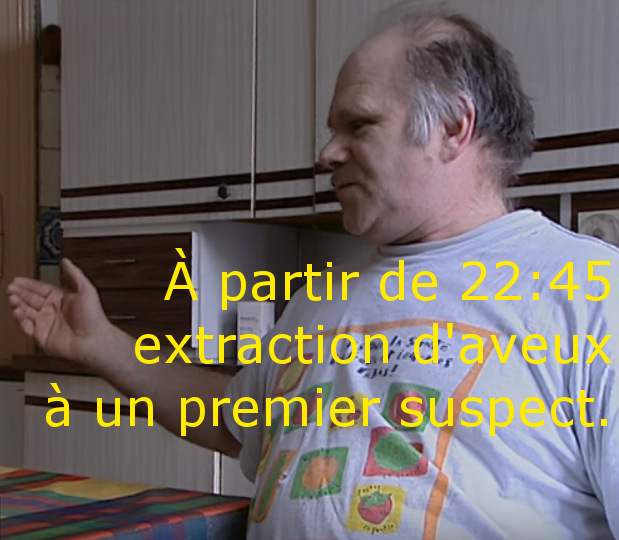
Cliquez sur l'image pour entendre comment H.
Leclaire,
premier homme à avouer les meurtres,
explique sa "confession".
Une troisième personne, premier suspect aux yeux de l'enquêteur,
était innocenté par un alibi bien établi. Bousculant toute
logique, Bernard Varlet et ses adjoints bâtiront sa "culpabilité"
en obtenant des aveux circonstanciés, qui convaincront deux jurys
d'assises de condamner ce malheureux Patrick Dils.
Nous allons voir comment les policiers et le juge d'instruction
ont construit un dossier autour d'aveux extorqués sans violence,
et négligé de nombreuses incohérences, tant la foi en cette "reine
des preuves" était puissante.
Une suspicion rocambolesque et des témoignages
isolés comme seules armes policières
L'inspecteur divisionnaire Varlet disposa
rapidement des éléments suivants :
- Les deux garçons, Cyril Beining et Alexandre
Bekrich, huit ans tous les deux, ne présentaient aucune
"lésion de défense" indiquant qu'ils aient tenté de se
protéger des pierres avec lesquelles l'assassin les a tués.
- On retrouve les pierres en question, tâchées
de sang et de cheveux, plusieurs petites et une grosse (5,8
kg), laquelle avait manifestement été utilisée pour écraser
leurs têtes.
- Les enfants ont été aperçus et entendus à
plusieurs reprises jusqu'à 17 h 15, jouant sur un talus où se
trouvaient des voies de chemin de fer désaffectées. Leurs
parents s'inquiètent de leur absence à partir de 18 heures,
les cherchent, puis préviennent la police. Ils seront trouvés
les crânes fracassés à 19 h 30 par un policier, sur le talus
de chemin de fer où ont les avait vu jouer.
- Le médecin légiste arriva à 20 h 35, constata
que les corps étaient encore tièdes au toucher. Examinant le
petit Alexandre, il remarqua que les bras, le thorax et les
jambes étaient déjà raides.
- En fonction des constations physiologiques sur
les corps, les médecins légistes fixent la mort à entre 17 h
15 et 18 h 15. Les témoignages ci-dessus collent avec cette
tranche horaire.
Une première suspicion au bien étrange motif
L'inspecteur Varlet reçut dans les premiers jours de
son enquête un appel téléphonique anonyme l'invitant à un
rendez-vous pour recevoir des révélations. Celles-ci n'étaient
qu'un conseil : s'intéresser à Dils, sans préciser le prénom. La
famille Dils habitait dans la rue en bas du talus de chemin de
fer. Mais voilà, de nombreux témoignages garantissaient qu'elle
n'était revenue ce dimanche qu'à 18 h 45 à
Montigny, donc après l'heure du crime.
Patrick, 16 ans, s'était bien absenté quelques instants, mais
moins de cinq minutes selon sa mère, son jeune frère et lui-même.
Emmené deux fois à la police, l'adolescent nia toute implication
dans le double meurtre.
Le policier va démonter l'alibi en se basant sur deux témoignages
isolés.
- Son père affirma qu'il s'était absenté du
domicile familial au moins un quart d'heure après leur retour
à Montigny et qu'il était réapparu pour le repas du soir,
avait enlevé son blouson et s'était mis à table. L'inspecteur
Varlet en conclut que, malgré les autres témoignages de la
famille, le suspect avait bien eu le temps de monter sur le
talus, de tuer les deux garçons et de revenir chez lui.
- Isabelle Deschang déclara plusieurs mois après
les faits qu'elle avait entendu — depuis son domicile situé à
170 m du lieu — vers 19 h 50 des cris d'enfants, supposés
venir du talus. « Je pourrais dire qu’il s’agissait des cris
apeurés d’un gosse qui est perdu dans le noir ». L'inspecteur
Varlet en déduira que malgré les indications des légistes et
des autres témoins (qui étaient passé en bas du talus après 17
h 15 sans plus entendre les enfants), les deux garçonnets
étaient encore vivants après le retour de la famille Dils à
Montigny.De plus, ce témoignage offre une hypothèse bienvenue
aux accusateurs, leur permettant de supposer que les enfants
n'étaient pas revenus chez eux à l'heure habituelle parce
qu'ils s'étaient perdus.
Ce changement d'heure de la mort n'est
pourtant possible que si l'on admet l'ensemble des trois
postulats suivants. a) Les estimations médico-légales qui
situent la mort des enfants au plus tard à 18 h 15 n'ont pas de
valeur. Ce changement d'heure de la mort suppose que les membres
et le torse d'un des enfants se seraient raidis en moins de deux
heures. Mais l'imagination de l'inspecteur Dils comble les trous
de la science. Écoutons-le.
En fait, les physiologistes savent depuis des générations que la
raideur après la mort survient dans un délai relativement
variable selon les individus. b) Les enfants très bruyants
jusque là, se seraient tus entre 17 h 30 et 18 h 50. c) Ils
n'auraient pas répondu au père de l'un d'eux, qui confirme être
monté sur le talus et les avoir appelés peu après 18 h 30.
L'inspecteur Varlet va de nouveau arrêter Patrick Dils et au bout
de trois interrogatoires supplémentaires, il en obtiendra les
aveux qu'il souhaitait.
L'inspecteur Varlet va expliquer au cours d'une interview les
trois étapes qui ont mené aux aveux : 1a peur, la mise en
confiance, les aveux. Écoutons-le.
Voici un récit des
circonstances de cette confession, tirés de l'ouvrage
d'Emmanuel Charlot, livre très lisible et très utile, surtout pour
qui s'intéresse aux côtés psychologiques de cette saga judiciaire,
"Affaire Dils-Heaulme la contre-enquête".
Le policier fera réitérer les aveux au suspect devant un de ses
collègues et puis devant le juge d'instruction, Mireille-Agnès
Maubert.
Celle-ci procédera à deux vérifications pour corroborer
les aveux de Patrick Dils.
- Une présentation de quatre pierres tachées de
sang en lui demandant de spécifier avec lesquelles il a frappé
les enfants.
- Une reconstitution, qui se fera
inhabituellement rapidement après les aveux.
Le juge d'instruction inculpera Patrick Dils, 16
ans à l'époque des faits, sur les bases que nous avons résumé
ci-dessus. Les aveux sont la pièce principale de l'accusation,
qui ne dispose d'aucune preuve matérielle. Par ailleurs, aucun
témoin n'a vu l'accusé se rendre sur les lieux du crime, aucun
témoin ne l'a vu sur le talus et encore moins accomplir les
meurtres. Personne ne l'a vu revenir du talus de chemin de fer,
personne ne l'a vu portant (sur lui-même ou sur ses vêtements)
les inévitables taches de sang provoquées par le mode opératoire
de ce double meurtre.
Un petit tableau pour montrer la situation de ces
aveux, au milieu des autres parties de la construction de
l'accusation :
Témoignage du père de
l'accusé, contraire à celui des autres membres de la
famille, affirmant qu'il s'est absenté au moins quinze
minutes, ayant dès lors le temps d'accomplir les deux
meurtres.
|
<------------->
Deux témoignages sans
lesquels la culpabilité de Patrick Dils est impossible
|
Témoignages d'Isabelle
Deschang, laissant croire que les enfants étaient encore
vivants à l'heure où P. Dils est accusé de les avoir tués,
malgré les témoignages contraire et les estimations
médicales.
|
|
Les aveux
de Patrick Dils, pièce principale du dossier.
|
|
La présentation des pierres à
l'accusé, censé désigner celles qui ont servi aux
meurtres.
|
<------------->
Deux éléments censés
confirmer les aveux de Patrick Dils |
La reconstitution des
meurtres.
|
Les aveux ne sont crédibles que si et seulement
si les conditions suivantes sont réunies :
- Le témoignage du père de l'accusé (qui lui
laisse le temps nécessaire aux meurtres) et celui d'Isabelle
Deschang (qui laisse croire que les enfants étaient encore
vivants au moment où l'accusé les aurait rejoints sur le talus
du chemins de fer) sont tous les deux inattaquables et
cohérents avec les aveux.
- Les aveux sont crédibles et cohérents.
- La présentation des pierres et la
reconstitution des meurtres sont crédibles et cohérentes avec
les aveux.
C'est évidemment ce que les magistrats auraient dû
vérifier avant de déférer l'adolescent devant les assises.
Procédons nous-même à ces vérifications.
Pour passer cette démonstration détaillée et aller directement
à la synthèse et au conséquences, cliquez ici.
Le déroulement des meurtres, tels que le raconta
Patrick Dils, et les quelques détails qui convainquirent
certains de sa culpabilité. La numérotation est ajoutée par
l'auteur de ces lignes, pour faciliter l'analyse. Les remarques sont de l'auteur de
ces lignes.
- Pour une raison qu'il dit ne pouvoir
s'expliquer, P. Dils est monté sur le talus, où il a vu les
deux enfants.
- Il s'est adressé au jeune Alexandre Bekrich,
qu'il connaissait. Remarque A :
l'enfant ne lui demande pas comment retrouver son chemin, ce
qui infirme la thèse issue du témoignage d'Isabelle Deschang
selon laquelle les victimes se seraient perdues (ce qui
expliquerait qu'ils ne soient pas rentrés chez eux à l'heure
habituelle).
- Pour une raison qu'il dit ne pas s'expliquer,
Patrick Dils a suivi les enfants puis a pris une pierre avec
laquelle il a frappé à la tête le petit Cyril, qui est tombé
sans crier.
- Alexandre Bekrich s'est alors mis à crier,
immobile Remarque B : la paralysie face au danger
se produit parfois mais s'accompagne d'aphonie, comme on
peut l'apprendre ici.
Cette explication
de Patrick Dils est donc hautement invraisemblable.
Patrick Dils dit avoir été effrayé par ces cris et avoir pris
une autre pierre, de même grosseur, pour le frapper à la tête
afin de le faire taire. Remarque C : la
première victime l'aurait vu prendre une pierre et
s'approcher de lui mais n'aurait pas tenté de fuir ni de se
protéger. La deuxième victime n'a ni tenté de fuir ni tenté
de se protéger malgré la vision de l'agression de son
camarade. Qu'aucun des deux enfants n'ait tenté de fuir ou
de se protéger est très peu vraisemblable. Remarque D : le
seul motif crédible que donne l'accusé de ses actes dans son
récit est la volonté de faire taire Alexandre au moment où
il le frappe la première fois.
- Patrick Dils raconte ensuite comment il a
écrasé la tête des victimes, déjà assommées, avec une très
grosse pierre.
- Il précise que cela faisait "le bruit de
melons que l'on écrase". Remarque E :
cette précision sera considérée comme "une chose que l'on
invente pas" et donc comme "un détail que seul l'assassin
pouvait connaître". À moins de considérer que les enfants
eussent un crâne dépourvu d'os, cette précision du récit
montre que l'accusait délirait ou bien souffrait d'un
problème auditif l'empêchant d'entendre les os craquer...
- Il
précise que la tête d'Alexandre s'est enfoncée dans le sol
sous ses coups. Remarque F : cette précision sera
également considérée comme "une chose que l'on invente
pas" et donc comme "un détail que seul l'assassin pouvait
connaître". Or il est évidemment impossible d'enfoncer ainsi
du ballast de chemin de fer, qui supporte des voies où
passent des locomotives de plusieurs dizaines de tonnes. Un
preuve de plus que Patrick Dils a déliré lors de ces
"aveux".
- Patrick Dils raconte ensuite qu'il est rentré
chez lui au plus vite et a monté les escaliers quatre à
quatre.
- Il termine sont récit en racontant qu'il s'est
changé et a enfilé son pyjama avant de se laver les mains. Il
précise que le sang a fait prendre à l'eau une teinte rose. Remarque G : l'accusé soutient avoir enfilé
son pyjama avant de rejoindre ses proches, alors que son
père soutient l'avoir revu en blouson. Ou bien le fils
racontait n'importe quoi au moment de ses aveux, ou bien le
père a des troubles de mémoire, mais alors on ne peut plus
se fier à son témoignage, le seul qui laisse le temps à son
fils de commettre les crimes. Remarque H : comment l'accusé
aurait-il pu enfiler son pyjama sans y faire plusieurs
taches de sang alors que ses mains en étaient pleines? Ses
proches auraient évidemment dû les apercevoir lorsqu'il est
redescendu à la salle à manger. La famille aurait-elle
compris le soir même que Patrick avait tué et aurait-elle
dissimulé sa culpabilité aux policiers? Mais alors comment
expliquer que les parents ne se soient pas entendus pour
témoigner à la police que l'accusé n'était sorti que moins
de cinq minutes, ce qui l'aurait innocenté?
Remarques supplémentaires quant à ces aveux
:
- L'avocat général du troisième procès d'assises
de l'accusé souligne ceci : les aveux comportent 11mentions de
mètres ou de centimètres. Comment l'accusé aurait-il pu
mémoriser autant de précisions géométriques au cours de ces
crimes qu'il est censé avoir accompli dans la précipitation en
moins de neuf minutes ? Mais il est mentionné dans le P.-V.
des aveux, les mots suivants de Patrick Dils «sur le plan que vous me présentez,
établi par l'inspecteur...», ce qui explique comment il a pu
donner toutes ces précisions: elles se trouvaient sous ses
yeux.
- Lors des réitérations de ses aveux, l'accusé
affirmera encore et toujours avoir accompli les meurtres pour
une raison qu'il ne s'explique pas, ou bien les avoir terminés
avec l'impression d'avoir accompli une mission. Bref,
rien qui ressemble à un vrai mobile.
- Malgré quelques tentatives, les enquêteurs
n'ont pu obtenir aucune explication de l'accusé par rapports
aux constats suivants, faits sur le lieu du crime :
- Une empreinte sanglante de main sur un
wagon à proximité des corps ;
- Le pantalon baissé d'une des victimes ;
- La présence de plusieurs mouchoirs en
papier, d'excréments, d'une cordelette de 70 cm et deux
tubes de "colle à rustines" (la "colle à rustine" est en
fait un cocktail de solvants) tout près des corps.
L'identification des pierres du crime
Le juge présenta au suspect P. Dils quatre pierres
tachées de sang en lui demandant de désigner celles qui lui
auraient servi pour tuer les deux enfants. Les pierres furent
ensuite envoyées pour expertise au professeur Lugnier. (Pour
cette partie, nous nous référons à l'ouvrage susmentionné de Me
Dominique Inchauspé, source bien plus sûre que les articles de la
presse.) Cette vérification ne peut-être concluante que si et
seulement si les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Les résultats de l'expertise
confirment la désignation des pierres meurtrières par l'accusé.
2° Les détails donnés par Patrick Dils dans ses
aveux au sujet du mode d'emploi des pierres pour assommer les
victimes puis les tuer sont confirmés par l'expertise.
Pour le point 1°, un calcul simple montre qu'il y a
quatre possibilités pour chaque pierre : pas frappé, frappé
Alexandre, frappé Cyril, frappé les deux enfants. Nous avons donc
au total 4 X 4 X 4 X 4 = 256 (et non pas mille comme beaucoup
l'ont affirmé) possibilités, ce qui paraît très élevé. Mais ! Une
seule des pierres présentées est assez grosse pour avoir pu
fracasser les crânes. Une autre n'est qu'un galet couvert de
quelques éclaboussures de sang, mais pas de cheveux. L'expert et
l'accusé déduiront tous les deux que ce galet n'a pas servi. Il
reste donc la pierre numérotée "5" et la pierre numérotée "7"
comme test vraiment significatif. Pour la pierre "5", l'inculpé
indique l'avoir utilisée pour frapper le seul Cyril, pour la
pierre "7", il indique ne l'avoir utilisé que pour frapper le seul
Alexandre.
L'expertise confirmera quelques semaines plus tard les
désignations de Patrick Dils pour la pierre "7", qui a frappé le
seul Alexandre. Mais le rapport spécifiera que la pierre "5" a été
utilisée pour les deux enfants à plusieurs reprises. Notre condition 1° n'est donc pas remplie puisque
Patrick Dils affirmait n'avoir utilisé cette pierre "5" que contre
un seul des enfants. Notre condition 2°
n'est donc pas remplie non plus puisque le petit Alexandre a été
frappé par les pierre "5" et "7" alors qu'au cours de ses aveux
Patrick Dils affirmait n'avoir frappé chacun des enfants qu'à une
seule reprise, avec des pierres différentes, avant d'utiliser la
grosse pierre pour les deux.
Bref, le juge d'instruction aurait dû conclure que l'expertise
contredisait les déclarations de l'accusé au sujet de
l'utilisation des diverses pierres, tant lors de ses aveux que
lors de la présentation des pierres. Un simple confusion entre
deux pierres semblables n'eût pas été significative puisque
l'accusé ne les avaient vues que quelques instants, dans la
pénombre de la nuit naissante et dans la précipitation. En
revanche, son erreur sur le mode opératoire (puisque on a bien
frappé à plusieurs reprises les deux enfants avec une des petites
pierres) doit faire admettre que l'expertise contredit fortement
les aveux.
La reconstitution du crime
Dans la logique de ses aveux, l'accusé n'aurait dû
avoir aucun mal à situer l'endroit où les enfants ont été
assassinés, puisqu'il avait donné pas moins de 11 précisions
chiffrées de distance. Or, (toujours dans le même ouvrage
susmentionné de Me Dominique Inchauspé), nous lisons quelques
remarques notées par le juge d'instruction lors de cette
reconstitution.
- "Mentionnons que nous sommes passés à deux
reprises à l'endroit où les victimes ont été découvertes.
L'inculpé n'a rien dit. Aucun arrêt n'a été fait, ni de notre
part, ni de la part de l'inculpé"
- "Au cours de la reconstitution, l'inculpé à
situé les faits à environ 42 m de l'endroit où les corps des
enfants ont été retrouvés."
Le témoignage du policier chargé d'organiser la
garde du périmètre lors de la reconstitution en dit long sur le
"sérieux" de cette organisation et de l'enquête en général.
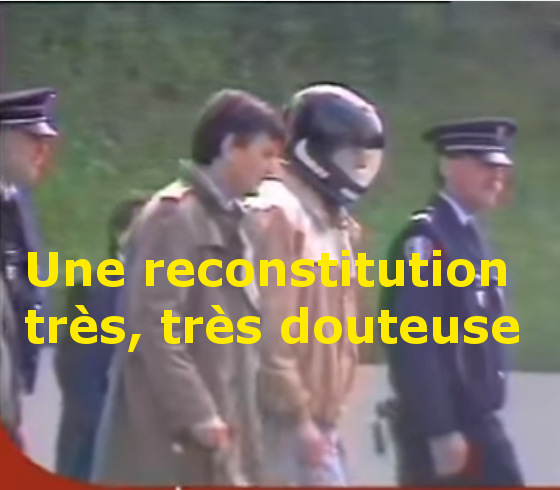 Cliquez sur l'image pour entendre le
témoignage du commandant de police.
Cliquez sur l'image pour entendre le
témoignage du commandant de police.
Synthèse
du dossier d'accusation,
commentaires et suites
- Le dossier
d'accusation est centré sur des aveux, qui comme nous
l'avons vu, comportent plusieurs invraisemblances quant au
comportement de l'accusé (pas de motivation donnée à ces
horribles actes de violence) et quant au comportement des
enfants (qui ne se protègent pas des coups, alors qu'ils
auraient vu l'accusé les préparer, ni ne tentent de fuir).
Plusieurs détails de ces aveux supposés les étayer sont
absolument invraisemblables et l'un d'eux est contradictoire
avec le seul témoignage (du père Dils) qui permet de croire
que Patrick Dils s'était absenté assez longtemps du domicile
pour pouvoir accomplir les crimes. Ces aveux sont
inexplicablement précis quant à certains points et muets
pour quelques autres.
- L'expertise des pierres
utilisées pour les meurtres montre des contradictions avec
les déclarations de l'accusé.
- La reconstitution montre que
l'accusé était loin de connaître aussi bien les lieux que ce
que ses aveux le laissaient croire.
- Il y a eu sérieux manquements
dans l'organisation de cette reconstitution, faite très vite
après les aveux.
Ces aveux ont été rétractés
par Patrick Dils dès sa première rencontre avec son avocat.
Quelques jour plus tard, il lui écrivit une
lettre pour réitérer cette rétractation.
Des points de vue contradictoires sur la
fiabilité des aveux
C'est là le sujet qui nous intéresse
au premier chef ! Peut-on honnêtement soutenir que les méthodes
policières utilisées n'ont pas abouti à faire dire n'importe
quoi à l'accusé? Celui-ci a expliqué les méthodes utilisées pour
l'amener à la confession souhaitée par les enquêteurs, qui
s'étaient relayés et avaient varié le ton de leurs
interrogatoires ("le méchant flic et le bon flic", ce n'est pas
que dans les mauvaises séries policières).
- D'abord lui rappeler que son
père avait déclaré qu'il s'était absenté au moins un quart
d'heure du domicile paternel après le retour de la famille à
Montigny. "Un papa, ça ne ment pas !" répétait l'inspecteur
face à lui.
- Lui répéter "Tu es arrivé, ils
étaient vivants, tu es reparti, ils étaient morts."
- Comme il avait déclaré avoir
mis cinq minutes pour aller chercher des timbres sur des
enveloppes jetées dans une benne, lui demander à de
multiples reprises ce qu'il avait fait pendant le reste du
temps supposé de son absence.
- Dans l'impossibilité de
répondre, Patrick Dils finit par déclarer qu'il avait un
trou de mémoire pour ces dix minutes. Un inspecteur plaça
alors entre eux une montre en lui disant que dix minutes,
c'est très long et qu'ils allaient se taire tous les deux
pendant ce temps.
Des avis différents sur la validité des aveux
en fonction de facteurs psychologiques
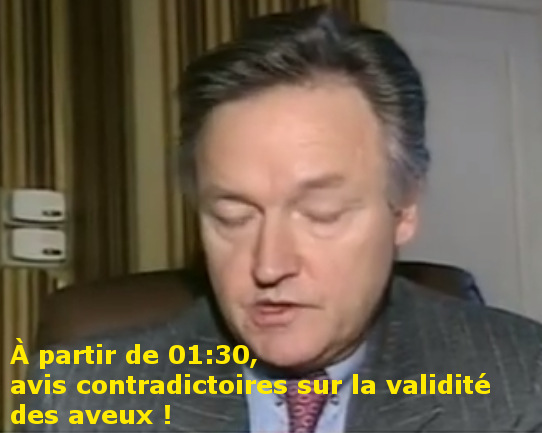
Cliquez sur l'image pour entendre deux avis opposés sur la
valeur de ces aveux
On pourrait soutenir, dans la même logique que celle de Me Rondu
lors de son intervention dans cette vidéo soutenir qu'il s'acharne
à démontrer la validité des aveux de Patrick Dils parce qu'il veut
cacher son propre rôle. Ce jour-là, il aurait été surpris par les
deux enfants au moment où il écrasait des restes de melons pour
les faire disparaître dans le ballast du chemin de fer, parce que
ceux-ci lui avaient servi pour faire tomber une nonagénaire,
mauvaise farce qui avait entraîné la mort de vielle femme. Il lui
restait à tuer les deux témoins malencontreux pour éliminer tout
risque d'être inculpé de la mort de la nonagénaire. Ce récit est
de ceux dont Me Rondu dira qu'on ne peut pas imaginer qu'il aient
été inventés. Donc, sauf à reconnaître qu'il est lui-même
l'assassin Me Rondu devrait renoncer à clamer qu'on ne peut pas
imaginer certains récits et à soutenir que ceux-ci sont donc
nécessairement vrais.
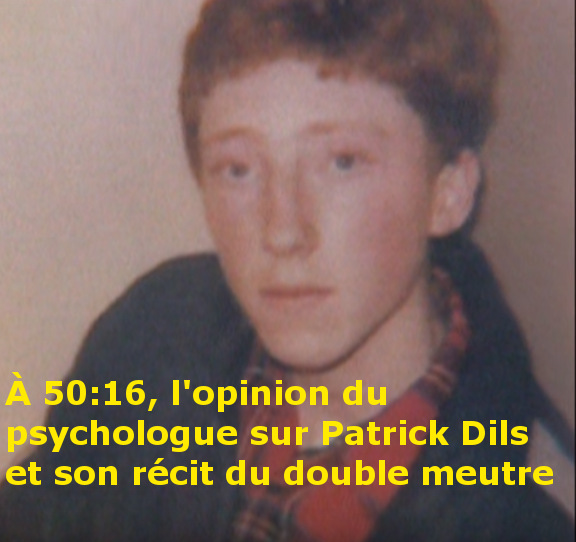 Cliquez sur l'image pour découvrir ce qui
disent les psys de P. Dils et de sa façon de raconter les
meurtres.
Cliquez sur l'image pour découvrir ce qui
disent les psys de P. Dils et de sa façon de raconter les
meurtres.
Deux dispositions de la procédure ont été violées lors de
l'obtention de ces aveux et leur réitération devant le juge
d'instruction :
- Ils ont été recueillis, au moins
partiellement, en dehors des auditions formelles.
- L'accusé étant mineur, il aurait dû être
assisté d'un avocat dès sa première comparution devant le juge
d'instruction.
Deux jurys d'assises ont pourtant, à 14
ans d'intervalle, déclaré Patrick Dils coupable sur la foi de
ces aveux !
Après une premier condamnation à perpétuité, Patrick
Dils a été rejugé suite à l’anéantissement de ce jugement par la
Cour de Cassation.
Rejugé à Reims en 2001, il a encore été condamné, à 25 ans de
prison. L'avocat général, Jean-Dominique Sarcellet, avait pourtant
demandé son acquittement, estimant en fonction des différents
témoignages que la chronologie supposée des actes de l'accusé
était invraisemblable.
Il fit appel et le troisième procès bénéficia d'un sérieux travail
d'enquête de la gendarmerie de Metz. Celle-ci recoupa les
témoignages et les compila dans un logiciel d'analyse criminelle
("anacrim"), qui permit de projeter à l'audience un plan du
quartier avec la figuration des personnes (accusé, témoins,
victimes), minute par minute, au long de l'après-midi funeste. Il
en résulta que scénario supposé du crime de l'accusé se heurtait à
des obstacles logiques. Ce troisième procès se termina par sa
libération en 2002, après quinze ans d'incarcération. La justice
octroya ensuite un million d'euros de dédommagement à Patrick et
sa famille. Mais comment l'argent pourrait-il compenser les 15
années de prison de l'innocent condamné et les conséquences pour
ses proches de cet opprobre?
La soumission comme preuve de
culpabilité !
C'est en fin de compte la soumission de
l'accusé Patrick Dils qui l'a fait condamné. Il s'était
soumis à la volonté des autorités qui insistaient pour qu'il
avoue, puis qu'il mime les gestes meurtriers lors de la
reconstitution et enfin qu'il détermine l'usage de chaque
pierre lors du double meurtre. Un caractère rebelle n'aurait
jamais accepté tout cela. L'aboutissement de cette
conception de la culpabilité basée sur les aveux est qu'il
vaut mieux être rétif qu'obéissant lorsque on est accusé
d'un crime. Autrement dit, la justice condamnera bien plus
facilement un citoyen soumis qu'un citoyen rebelle.
Une nouvelle piste pour cette affaire, qui montre les autres
conséquences de cette foi dans les "aveux circonstanciés"
Le jugement de la Cour de Cassation, qui permit à P.
Dils d'être rejugé, puis acquitté faisait suite à la découverte de
la présence d'un tueur récidiviste sur les lieux du crime. Ce
criminel, Francis Heaulme, avait d'ailleurs fait un séjour en
hôpital psychiatrique peu après les meurtres et l'on doit
s'étonner qu'il ait échappé aux investigations faites dans ce
milieu par des enquêteurs à l'époque. Il a été condamné (dans une
série de procès entre 1994 et 2004) pour huit meurtres commis
après ceux de Montigny (et un auparavant). S'il avait été arrêté à
cette époque au lieu de Patrick Dils, ces malheureux seraient
encore en vie. Deux enfants, Joris Viville (9 ans) et Laurence
Guillaume (14 ans) figurent dans cette triste liste. Contrairement
aux deux victimes de Montigny, qui ont été manifestement assommées
par surprise avant d'être achevées, Joris et Laurence ont bien eu
de le temps de comprendre le sort qui les attendait.
Il y a par ailleurs une contradiction à considérer que la
présence de Francis Heaulme sur les lieux du crime était un
élément nouveau susceptible de remettre en cause la
culpabilité de Patrick Dils. Les éléments sur base desquels il
avait été condamné n'étaient en rien modifiés par le fait de
cette présence. En revanche, le témoignage de Francis Heaulme
qui disait avoir vu les enfants morts (et donnait un détail
qui n'avait jamais été divulgué) pouvait sans doute s'ajouter
aux divers éléments qui montraient que les enfants étaient
morts avant le retour de la famille Dils. Mais n'a-t-on pas
tout simplement admis indirectement, par cette décision, que
Patrick Dils avait été condamné parce qu'il était à ce moment
le seul coupable potentiel disponible?
Les familles des deux victimes de Montigny ont donc dû admettre
que la justice leur présentait un nouveau suspect en même temps
qu'elle acquittait celui qui leur avait été désigné comme le
coupable.
Mais voilà, la justice de Metz était peu disposée à monter un
quatrième procès d'assises dans cette affaire et Francis Heaulme
bénéficia d'un non-lieu.
Quand l'amour d'une mère vient à bout de tous
les obstacles.
Chantal Beining, la mère du petit Cyril, a été la
personne la plus touchée parmi les familles des victimes.
Son ménage a été brisée et sa petite pension de retraite a été
consacrée en partie à payer les frais de justice. Elle a pourtant
tenu à faire appel de ce non-lieu et obtenu que Francis Heaulme
comparaisse aux assises pour ce double meurtre. Malade, abandonnée
( voire vilipendée) par les autres parties civiles, seule face à
l'inertie de la magistrature de Metz (qui semblait s'intéresser
plus à Patrick Dils malgré son acquittement qu'à Francis Heaulme),
elle est parvenue à faire comparaitre le tueur et à lui faire face
lors du quatrième procès d'assise de cette affaire. Elle a ainsi
tenu sa promesse à son fils, celle de faire établir l'identité de
son meurtrier. Francis Heaulme a été condamné le 17 mai 2017 à la
prison à vie pour ce double meurtre, plus de trente ans après les
faits. Son procès s'est étendu sur trois semaines et ses avocats
ont eu pour principal moyen de défense... les aveux de Patrick
Dils. Mais les jurés ne sont plus tombés dans le piège de cette
preuve en carton et ont rédigé des motivations de leur jugement
que l'on peut lire ici.
Les avocats de Francis Heaulme ayant interjeté appel, il y aura un
cinquième procès d'assise, nouvelle épreuve pour l'émouvante
madame Beining et nouvelle occasion, à n'en pas douter, pour les
inconditionnels des aveux, de brandir ceux de Patrick Dils.
Les erreurs de raisonnement commises dans cette
tragique affaire
La plus grosse est évidemment de se fier à des
aveux, surtout dans de telles conditions. Trois personnes
ont avoué un crime dont une quatrième était coupable. Comment
a-t-on pu valider les aveux du troisième, après avoir dû
reconnaitre l'innocence des deux premiers à avoir avoué? Si un
témoin désignait une personne comme l'auteur d'un délit, puis
une deuxième et enfin une troisième, plus personne ne lui
accorderait la moindre confiance. Pourtant, la religion des
aveux permet de considérer comme valides ceux obtenus auprès
d'une personne, qui avoua après que deux autres l'eurent fait,
auprès de la même équipe policière, pour une même affaire.
La deuxième est de considérer que Dils était
coupable "parce que ça ne pouvait être que lui" après la
mise hors cause des deux personnes qui avaient avoué avant lui.
C'est bien ce que répliqua la juge d'instruction à Patrick Dils
lorsqu'il rétracta ses aveux face à elle. Elle semblait
considérer que le coupable faisait nécessairement partie des
personnes interpellées par la police dans le cadre des affaires
et que Dils étant le seul de cet ensemble à n'avoir pas été
disculpé, il était forcément le seul coupable. C'était négliger
le fait que les lieux étaient accessibles à n'importe qui. Il y
a donc bel et bien des millions de coupables potentiels. Donner
a priori à choisir entre la culpabilité de Heaulme et celle de
Dils est donc illogique. On ne peut absolument pas soutenir que
l'un d'eux est coupable simplement parce que l'on tient pour
certain que l'autre ne l'est pas.
Le témoignage de Mlle Deschang comporte un
biais cognitif évident, or l'accusation l'a considéré
comme "irréfutable" Cette personne dit avoir entendu des cris,
comme ceux d'enfants perdus dans le noir, en provenance du
talus, zone déjà plongée dans les ténèbres à ce moment. Quel
parent n'a-t-il pas eu un jour des difficultés à interpréter les
cris de son propre enfant, surtout lorsqu'il était caché à sa
vue? Excitation du jeu? douleur? peur? colère? Pourtant cette
personne pense à la peur du noir comme cause de cris d'enfants
qu'elle ne connaît pas et qu'elle ne voit pas. Le biais est
évident: comme elle voit une zone sombre, le talus, en entendant
les cris, elle construit instinctivement une réalité cohérente à
partir des données de ses divers sens: l'obscurité peut
expliquer les cris d'enfants qui se trouveraient dans cette
zone. Donc, ils proviennent du talus et sont des cris de peur.
Ce genre de travail inconscient de construction d'une réalité
cohérente à partir de nos sens est bien connu et explique des
phénomènes comme les illusions d'optique. Voir à ce sujet
l'ouvrage de Daniel Dennett "La Conscience expliquée", chez
Odile Jacob.
Notons aussi que d'autres enfants ont pu crier dans les
environs et que postuler que les enfants entendus par cette
personne étaient les deux victimes est arbitraire.
Ces erreurs en ont entraîné d'autres !
On a pu voir au long de mes explications combien nombreuses
étaient les incohérences dans la thèse de l'accusation. Une
telle suite d'absurdités est évidemment due au "biais de
confirmation", bien connu des psychologues spécialistes de la
cognition, qui fait que l'on ne prend en compte que les éléments
qui appuient la thèse auquel on a déjà adhéré et non pas ceux
qui peuvent l'invalider.
Voir ici les questions subsistant dans les
épisodes de cette saga judiciaire
Pour en savoir plus :
Liens vidéos :
Le long
combat de Patrick Dils face à la justice
Reportage
sur l'ensemble de l'affaire
Les
réflexions de François-Louis Coste, avocat général lors du
dernier procès de Patrick Dils
Réflexions
de quelques protagonistes sur ce fiasco judiciaire Le
deuxième intervenant, l'avocat Thomas Hellenbrand, explique
comment la recherche systématique d'aveux a entravé la découverte
de la vérité.
Longue
interview de P. Dils, les interrogatoires, les aveux, la
détention, la réintégration
Ecrits
Beaucoup
de points soulevés avant le deuxième procès aux assises article en ligne, dans
lequel (entre autres) un ex-avocat d'une partie civile met
sérieusement en cause le déroulement de la reconstitution
Article
scientifique sur la fabrication des souvenirs et des aveux
L'accès à
l'entièreté de l'article n'est pas libre. L'achat de ce numéro
du magazine scientifique vaut la dépense pour qui veut
comprendre comment tant de contre-vérités sortent des
interrogatoires policiers mais aussi d'autres situations, en
particuliers certaines psychothérapies.
"Je voulais juste rentrer chez moi" Le récit (aux Editions
Michel Lafon) de Patrick Dils
"Prisonnier de Mao" Le récit publié par Jean Pasqualini de son
arrestation en Chine, de ses interrogatoires et de son
internement. On verra à quel point le "lavage de cerveau",
non-violent, peut faire intégrer au prisonnier n'importe
quelle contre-vérité. On y lira aussi cette considération d'un
interrogateur chinois qui explique que les suspects de type
"robinet" débitent leurs aveux d'un seul tenant à un certain
moment, après avoir auparavant tout nier, comme le décrit
l'inspecteur Varlet à propos de Patrick Dils.
"Affaire Dils-Heaulme la contre-enquête" ouvrage
assez complet d'Emmanuel Charlot, qui se lit agréablement.
"L'erreur judiciaire" de Dominique Inchauspé, ouvrage sérieux, et
même aride, qui consacre 44 pages à cette affaire de
Montigy-lès-Metz.
Texte de Tiesse Di Hoye pour le site "Les
preuves en carton"
Remarque ? suggestion ? question ? Contacter le
site par courrier
électronique
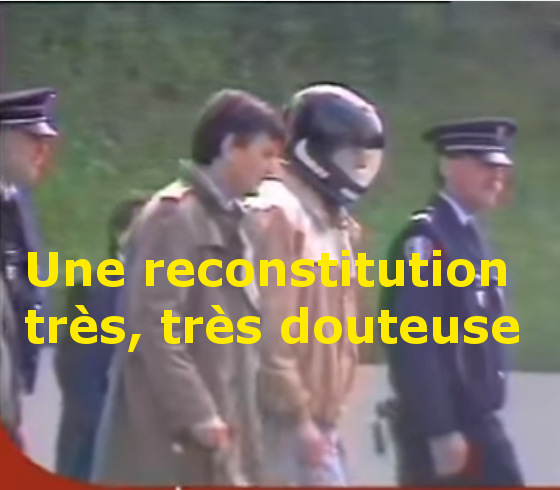 Cliquez sur l'image pour entendre le
témoignage du commandant de police.
Cliquez sur l'image pour entendre le
témoignage du commandant de police.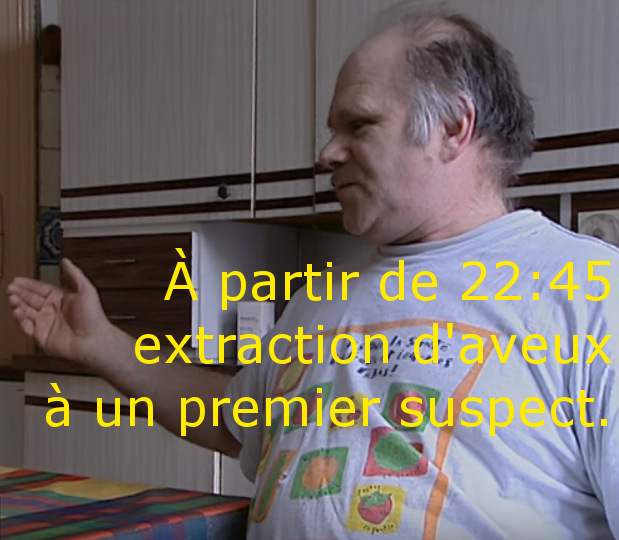
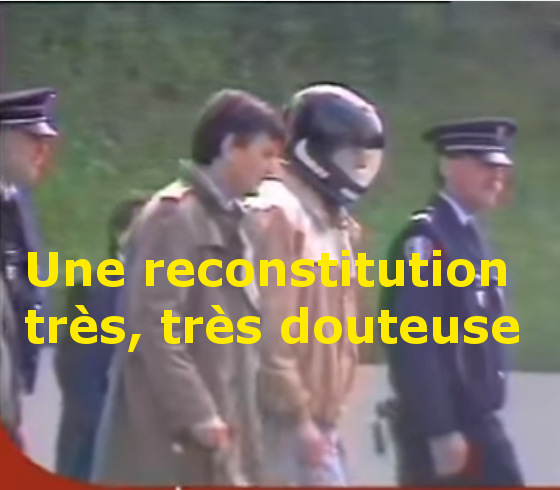 Cliquez sur l'image pour entendre le
témoignage du commandant de police.
Cliquez sur l'image pour entendre le
témoignage du commandant de police.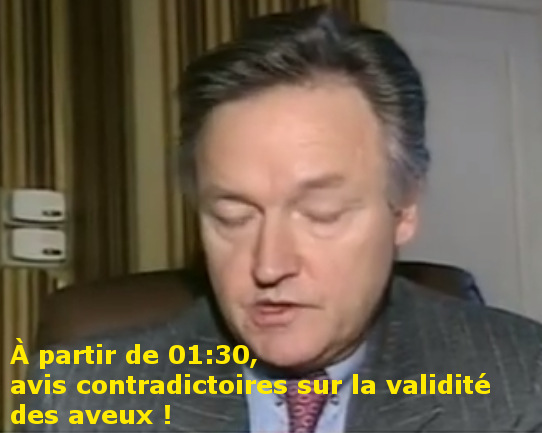
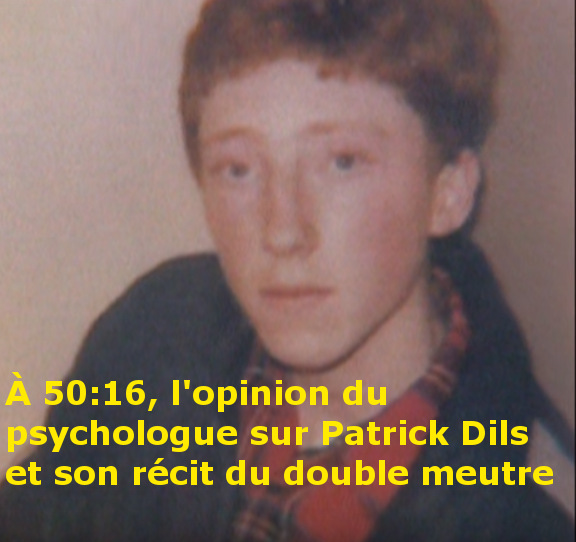 Cliquez sur l'image pour découvrir ce qui
disent les psys de P. Dils et de sa façon de raconter les
meurtres.
Cliquez sur l'image pour découvrir ce qui
disent les psys de P. Dils et de sa façon de raconter les
meurtres.